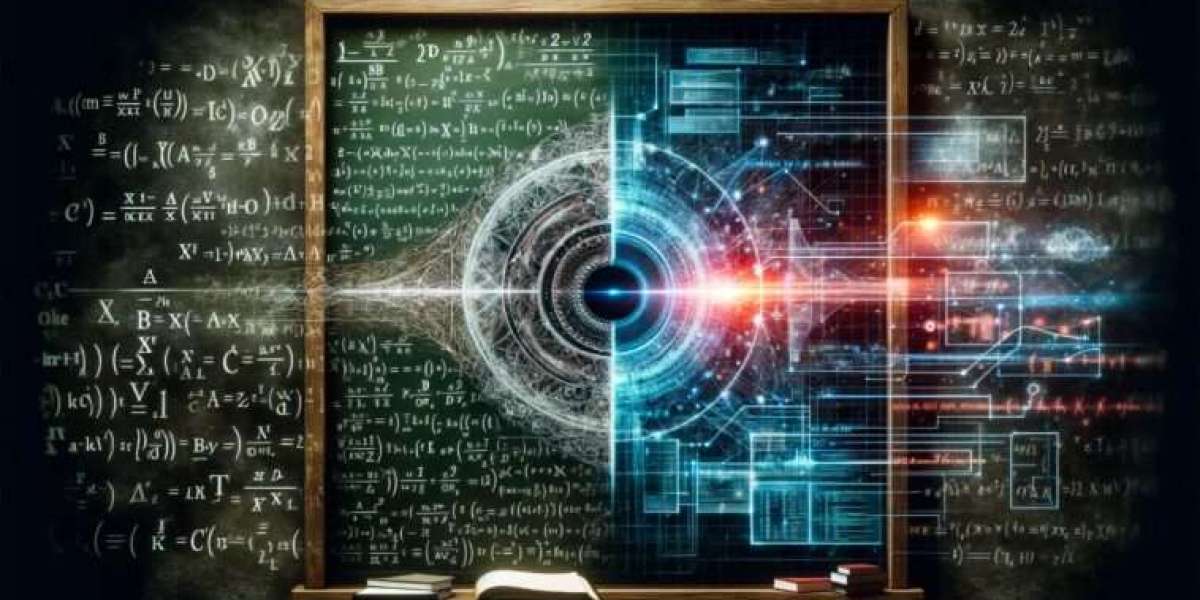Édité par la Société Internationale de Natiométrie (SIN)
En collaboration avec le Fonds International de Dotation pour la Natiométrie (FIDN).
Genève, octobre 2025
I. Préambule — Un nouveau paradigme pour mesurer le monde :
Depuis un demi-siècle, les indicateurs du développement humain, économique ou environnemental ont tenté de décrire la complexité du progrès global. Mais ces mesures, fragmentaires et souvent désynchronisées, laissent échapper l’essentiel : la dynamique intérieure des civilisations, leur cohérence, leur orientation et leur stabilité à long terme.
La Natiométrie introduit une rupture conceptuelle majeure. Elle ne cherche pas seulement à quantifier les résultats économiques ou sociaux, mais à évaluer la qualité du champ civilisationnel — c’est-à-dire la capacité d’une nation ou d’un ensemble régional à maintenir sa cohérence, à se transformer sans se détruire, et à créer du sens collectif dans un monde en mutation.
Le Rapport mondial sur la stabilité civilisationnelle (RMSC) a pour vocation d’établir chaque année un état du champ civilisationnel planétaire, fondé sur les indicateurs natiométriques et les mesures issues du Mécanisme d’Évaluation d’Impact Civilisationnel (M.E.I.C.).
II. Cadre scientifique et institutionnel :
Le RMSC est élaboré conjointement par :
-
La Société Internationale de Natiométrie (SIN), autorité scientifique et gardienne du Natiomètre.
-
Le Fonds International de Dotation pour la Natiométrie (FIDN), organe opérationnel et financier chargé d’appliquer les principes de la finance natiomètrique à l’échelle mondiale.
-
Les Observatoires régionaux du champ civilisationnel (ORCC), implantés sur chaque continent et associés à des centres de recherche locaux.
Objectif :
Mesurer, interpréter et représenter la stabilité civilisationnelle mondiale, afin d’orienter les politiques internationales, les investissements et les coopérations scientifiques vers un équilibre durable entre les nations.
III. Les indicateurs natiométriques globaux :
Le système d’observation repose sur cinq familles d’Indicateurs de Performance Civilisationnelle (IPC), définies dans le cadre du M.E.I.C. :
-
Cohérence structurelle (C₁) — mesure l’intégrité interne des institutions, la qualité du lien social et la robustesse de la gouvernance.
-
Vitalité culturelle (C₂) — évalue la créativité symbolique, la transmission intergénérationnelle et la diversité culturelle vivante.
-
Énergie systémique (C₃) — quantifie la dynamique économique, technologique et scientifique du système national.
-
Conscience éthique et écologique (C₄) — mesure la compatibilité entre progrès et responsabilité planétaire.
-
Indice de paix structurelle (C₅) — exprime la stabilité des équilibres internes et la résilience face aux tensions géopolitiques.
Ces cinq familles forment un pentagramme civilisationnel, symbole d’équilibre dynamique. Leur combinaison permet de calculer le Vecteur global de stabilité civilisationnelle (VSC) d’une nation, défini par :

Le VSC devient ainsi l’unité de mesure principale du Rapport mondial.
IV. Cartographie mondiale du champ civilisationnel :
1. Structure du champ :
Le champ civilisationnel mondial est représenté sous forme de carte vectorielle dynamique, dans laquelle chaque nation apparaît comme un nœud énergétique dont la densité, la polarité et la fréquence varient selon les cycles de 128 ans définis par le cadran natiométrique.
Les zones de forte cohérence apparaissent comme des régions de convergence — véritables bassins de stabilité civilisationnelle — tandis que les zones de déséquilibre révèlent des tensions systémiques, susceptibles d’évoluer vers des crises politiques, identitaires ou technologiques.
2. Dynamiques régionales (exemple) :
-
Europe occidentale : phase de saturation civilisationnelle (stabilité institutionnelle élevée, cohérence culturelle en déclin).
-
Asie de l’Est : phase d’ascension accélérée (forte cohérence technologique et culturelle, tension écologique).
-
Afrique du Nord et Sahel : phase de recomposition (réémergence des structures endogènes, recherche d’un récit civilisationnel propre).
-
Amériques : transition vers une phase d’équilibre post-industriel (stabilité relative, polarisation sociale).
-
Eurasie : oscillations entre recomposition identitaire et expansion géopolitique (forte énergie systémique, cohérence fluctuante).
V. Analyse des transitions civilisationnelles :
Le rapport identifie des zones de transition de phase dans le champ mondial. Ces transitions se manifestent par des variations synchronisées de plusieurs indicateurs : effondrement des récits collectifs, mutation des systèmes de valeur, ou réorientation des flux économiques et technologiques.
Typologie des transitions observées :
-
Transition ascendante : émergence d’un modèle culturel ou scientifique nouveau (ex. : renaissance technologique).
-
Transition de rupture : effondrement partiel des structures sans recomposition immédiate (ex. : guerre civile ou effondrement institutionnel).
-
Transition de convergence : harmonisation régionale autour de valeurs partagées (ex. : union civilisationnelle).
-
Transition de dissipation : perte de cohérence systémique, souvent liée à une saturation technologique ou idéologique.
L’objectif du rapport n’est pas de juger, mais de comprendre les lois d’évolution civilisationnelle, afin de prévenir les crises et d’orienter les investissements dans les zones à fort potentiel de recomposition.
VI. Corrélations globales : paix, économie et innovation.
Les premières analyses natiométriques montrent des corrélations robustes entre :
-
la cohérence civilisationnelle et la stabilité économique à long terme,
-
la vitalité culturelle et la capacité d’innovation scientifique,
-
la conscience éthique et la préservation écologique,
-
la stabilité structurelle et la réduction des conflits armés.
Ainsi, la stabilité civilisationnelle apparaît comme le déterminant fondamental du développement durable. Le FIDN et la SIN y voient le levier principal d’une paix structurelle, fondée non sur la dissuasion, mais sur la résonance civilisationnelle des nations.
VII. Recommandations stratégiques :
-
Institutionnaliser les observatoires régionaux du champ civilisationnel, dotés d’équipes pluridisciplinaires associant physiciens, économistes, diplomates et philosophes.
-
Intégrer les indicateurs natiométriques aux rapports onusiens sur le développement durable et la gouvernance.
-
Former une génération d’analystes natiométriques, capables d’interpréter les données du champ civilisationnel.
-
Créer un tableau de bord mondial de la stabilité civilisationnelle, mis à jour annuellement par la SIN et le FIDN.
-
Mobiliser la finance consciente (via le FIDN) pour soutenir les projets améliorant directement la cohérence des sociétés humaines.
VIII. Conclusion — Vers un équilibre planétaire conscient.
L’humanité entre dans une ère où la survie ne dépend plus seulement de la puissance ou de la richesse, mais de la cohérence civilisationnelle. Les nations, telles des organismes vivants, ne peuvent croître sans équilibre intérieur, ni prospérer sans résonance avec les autres.
Le Rapport mondial sur la stabilité civilisationnelle inaugure une nouvelle gouvernance des civilisations : celle qui s’appuie sur la dynamique natiométrique des civilisations, sur la mesure du sens, et sur la conscience comme ressource stratégique.
La Natiométrie, en dotant le monde d’un instrument de diagnostic universel, ouvre la voie à une une diplomatie de la résonance civilisationnelle, à une économie de l’équilibre, et à une finance du vivant collectif.