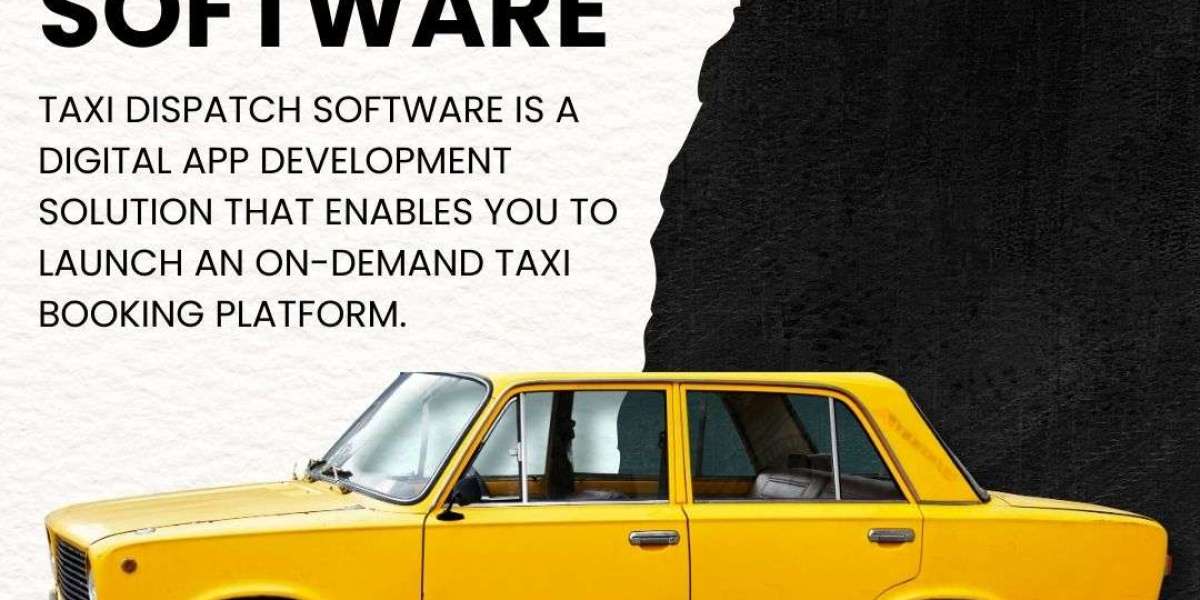Introduction :
Dans une Algérie confrontée aux turbulences géopolitiques régionales et à la résurgence de tensions identitaires internes, la tenue d’un colloque national sur « La promotion de l’amazighité dans le cadre de la sécurité identitaire », à l’occasion du 30ᵉ anniversaire du Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA), constitue un tournant discursif et stratégique. Il ne s’agit plus uniquement de reconnaître Tamazight comme langue nationale et officielle, mais de l’inscrire pleinement dans une politique de consolidation de la souveraineté culturelle et de la stabilité sociétale. L’État algérien, à travers ce geste institutionnel, semble affirmer une volonté nouvelle : intégrer la diversité comme fondement de l’unité nationale, plutôt que de l’envisager comme une menace.
Au cœur de cette démarche émerge une notion encore peu explorée dans le lexique politique classique : la sécurité identitaire. Ce concept, situé à l’intersection de la géopolitique, de la mémoire collective et des dynamiques socioculturelles, traduit une ambition profonde : neutraliser les failles symboliques susceptibles d’être instrumentalisées par des puissances étrangères ou des acteurs internes aux desseins délétères. Ce tournant appelle non seulement des réponses politiques, mais également des outils conceptuels capables d’objectiver les tensions, de modéliser les vulnérabilités et de projeter des trajectoires d’équilibre. C’est précisément là que l’apport de la Natiométrie, science émergente du phénomène-nation, peut offrir une grille de lecture rigoureuse et opératoire.
Colloque national sur « La promotion de l’amazighité dans le cadre de la sécurité identitaire », à l’occasion du 30ᵉ anniversaire du Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA).
I. Un colloque à forte charge symbolique : amazighité et sécurité identitaire.
Le colloque organisé par le HCA ne se réduit pas à un simple exercice académique. Il marque l’aboutissement – et peut-être l’amorce d’un nouveau cycle – dans la manière dont l’État algérien envisage sa relation à l’amazighité. Historiquement reléguée aux marges du récit national, la langue et la culture amazighes sont aujourd’hui placées au centre d’un projet de refondation identitaire. Cette volonté s’inscrit dans les orientations stratégiques énoncées par le Président de la République, visant à ériger Tamazight non seulement en langue d’enseignement et d’administration, mais en pilier symbolique de la cohésion nationale.
Prenant la parole à l’ouverture du colloque, le Secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, a souligné avec force le lien entre amazighité et sécurité identitaire, affirmant que « la souveraineté culturelle se préserve et se construit sur la base de la pleine reconnaissance de toutes les composantes de la Nation ». Une déclaration qui fait écho à une conviction institutionnelle de plus en plus assumée : l’unité n’est possible que si elle est inclusive, et cette inclusion ne peut se faire sans revalorisation effective du pluralisme linguistique et culturel.
Cette dynamique, cependant, reste fragile. L’incident provoqué par les propos de Mohamed Lamine Belghit, qualifiant l’amazighité de « création franco-sioniste » sur une chaîne étrangère, illustre à quel point la question identitaire peut être instrumentalisée, notamment par des forces extérieures cherchant à fissurer le socle national. La réaction rapide et ferme de l’Établissement public de télévision algérien (ENTV), dénonçant une tentative de provocation et désignant les Émirats arabes unis comme acteurs d’une ingérence médiatique manifeste, témoigne d’une prise de conscience aiguë : l’identité est un terrain stratégique. Et toute faiblesse dans sa gestion peut se traduire par une perte de contrôle symbolique, donc politique.
Face à ces enjeux, le colloque du HCA apparaît comme un acte de souveraineté douce, un moment de recentrage sur les fondements propres du vivre-ensemble algérien. Il consacre un principe fondamental : l’unité nationale ne saurait être pensée comme uniformité imposée, mais comme harmonie active des différences reconnues. Et c’est dans cette articulation entre reconnaissance et résilience que le concept de sécurité identitaire prend toute sa portée.
II. La sécurité identitaire : un paradigme émergent au croisement de la culture, de la souveraineté et de la géopolitique.
La notion de sécurité identitaire marque un tournant dans les approches contemporaines de la stabilité nationale. Longtemps reléguée à la périphérie des préoccupations étatiques, la dimension culturelle et symbolique de la sécurité apparaît aujourd’hui comme un pilier central, au même titre que la sécurité militaire, alimentaire ou énergétique. Il ne s’agit plus seulement de défendre un territoire, mais de protéger un imaginaire collectif, un récit de soi en tant que Nation. Dans un monde globalisé où les conflits ne sont plus uniquement armés, mais narratifs, l’identité devient un champ de bataille stratégique.
La sécurité identitaire consiste dès lors à anticiper, contenir et neutraliser toute tentative de fragmentation du tissu symbolique national. Elle implique une vigilance permanente face aux discours déstabilisateurs, aux entreprises de réécriture historique malveillante, ou aux injonctions uniformisantes de la mondialisation néolibérale. Cette sécurité ne peut être assurée que par l'inclusion active de toutes les mémoires, langues, croyances et récits fondateurs qui composent la mosaïque nationale. Là où le déni produit la division, la reconnaissance fonde la cohésion.
Sur le plan géopolitique, cette approche ouvre une nouvelle grille de lecture. Les attaques identitaires, à travers les médias, les réseaux sociaux ou les relais diplomatiques, ne sont pas de simples provocations. Elles s’inscrivent dans des stratégies de guerre hybride, où la désintégration symbolique d’un peuple précède ou accompagne sa fragilisation institutionnelle. Le cas des propos de Belghit en est une illustration. Ce n’est pas un hasard si cette attaque ciblait l’amazighité : en tentant d’en faire un corps étranger, elle cherchait à miner un fondement essentiel de l’algérianité plurielle. Elle relevait d’une stratégie d’inversion narrative, visant à délégitimer ce qui constitue, en réalité, l’un des ciments historiques les plus profonds de la Nation.
C’est pourquoi la sécurité identitaire ne peut être pensée uniquement dans une logique défensive. Elle doit aussi se décliner dans une stratégie d’affirmation : réhabiliter les langues marginalisées, réintégrer les récits refoulés, redonner droit de cité aux cultures tenues en lisière. En ce sens, la promotion de Tamazight, non comme un ajout symbolique, mais comme un vecteur de souveraineté culturelle, représente un acte structurant. Il ne s’agit pas d’un simple geste patrimonial, mais d’un déploiement stratégique visant à immuniser la Nation contre les dislocations narratives.
D’un point de vue culturel, la sécurité identitaire repose sur un postulat clair : aucune société ne peut se projeter dans l’avenir si elle n’est pas en paix avec elle-même. Cette paix intérieure ne se décrète pas. Elle se construit par une œuvre patiente de reconnaissance, d’éducation et de dialogue. Il ne suffit pas d’enseigner Tamazight ; encore faut-il lui reconnaître une dignité épistémique, une place dans la production du savoir, une voix dans la réflexion nationale.
Dans ce contexte, la sécurité identitaire ne se limite pas à un enjeu algérien. Elle devient un concept opératoire global, applicable à toutes les nations confrontées aux tensions entre unité politique et diversité culturelle. Elle suppose une transformation des doctrines de sécurité, qui doivent désormais intégrer les dimensions symboliques, linguistiques et historiques de l’intégrité nationale.
C’est dans cette perspective que la Natiométrie, en tant que science de la dynamique des nations, apporte des instruments conceptuels, quantitatifs et prospectifs, permettant de mesurer, modéliser et anticiper les fractures identitaires. En objectivant les tensions culturelles au sein d’un espace de phase civilisationnel, en simulant les scénarios d’effritement ou de réconciliation, elle offre une boussole précieuse pour guider les politiques de sécurité identitaire vers plus de lucidité et d'efficacité.
III. Le Natiomètre comme outil d’objectivation et de pilotage de la sécurité identitaire.
Dans un monde de plus en plus complexe, marqué par l’accélération des mutations culturelles, technologiques et géopolitiques, la question identitaire ne peut plus être traitée de manière empirique ou simplement idéologique. Elle requiert des instruments d’analyse rigoureux, capables d’identifier les tensions émergentes, de quantifier les degrés de cohésion ou de dislocation symbolique, et d’éclairer les décisions stratégiques. C’est dans cette optique que s’inscrit le Natiomètre, fruit de la discipline émergente qu’est la Natiométrie, pensée comme une science de la dynamique civilisationnelle.
Conçu comme un système algorithmique et quantique, le Natiomètre repose sur une modélisation systémique du phénomène nation en tant que méta-système vivant, structuré par des variables culturelles, linguistiques, politiques, sociales et psychiques. Il ne s’agit pas d’un simple outil statistique, mais d’un instrument de navigation civilisationnelle, capable de représenter un peuple dans son devenir, dans ses oscillations, dans ses points de bascule. Il se fonde sur un cadran temporel de 128 ans, couplé à un espace de phase multidimensionnel dans lequel sont modélisées les tensions internes et les interactions identitaires.
Dans le cadre de la sécurité identitaire, le Natiomètre permet plusieurs avancées déterminantes :
1. Mesurer la cohésion identitaire à un instant T :
Grâce à un ensemble de variables conjuguées (ethnique/civique, transcendantal/fonctionnel, universel/particulier, etc.), le Natiomètre peut situer une nation dans un espace de phase civilisationnel, en déterminant ses axes de tension et ses pôles de stabilité. Cela permet d’objectiver les déséquilibres identitaires et d’évaluer leur intensité avant qu’ils ne se traduisent en crises ouvertes.
2. Simuler les trajectoires possibles :
Par l’usage de modèles dynamiques et probabilistes (type Monte-Carlo), combinés à des données historiques, linguistiques et sociopolitiques, le Natiomètre est en mesure de générer des scénarios prospectifs : quels effets aurait l’abandon d’une langue ? Quelle dynamique enclenche la reconnaissance d’une mémoire ? Comment se propagent les discours de haine dans un espace symbolique donné ? Ces simulations permettent d’anticiper les points de rupture, mais aussi d’identifier les leviers d’harmonisation.
3. Cartographier les menaces symboliques :
Le Natiomètre intègre un module de détection des attaques narratives, des tentatives de manipulation identitaire ou des ingérences symboliques, en repérant les anomalies dans les flux discursifs, les glissements lexicaux ou les réseaux de désinformation. Il agit ainsi comme un radar culturel, identifiant les signaux faibles avant qu’ils ne se transforment en orages identitaires.
4. Optimiser les politiques publiques culturelles :
Plutôt que de réagir dans l’urgence, le Natiomètre permet une planification stratégique à long terme des politiques linguistiques, éducatives et mémorielles. Il aide à calibrer les efforts de reconnaissance et d’intégration identitaire en fonction des tensions mesurées, favorisant une répartition équilibrée des ressources symboliques de l’État.
5. Fonder une diplomatie culturelle souveraine :
Sur le plan international, la Natiométrie offre un cadre conceptuel permettant aux nations de défendre leur diversité contre les narratifs homogénéisants ou disqualifiants. Elle donne à l’État les moyens de parler scientifiquement de son identité, non comme d’un dogme, mais comme d’un écosystème vivant, complexe, en constante évolution.
Loin d’être un simple outil de mesure, le Natiomètre constitue un véritable organe cognitif de la souveraineté identitaire. Il donne aux États conscients de leurs responsabilités civilisationnelles les moyens d’un pilotage éclairé, rationnel et anticipateur de leur devenir symbolique. Dans le cas de l’Algérie, il pourrait contribuer à renforcer la trajectoire d’intégration de l’amazighité, non seulement comme reconnaissance, mais comme moteur actif de sécurité nationale et de puissance culturelle.
Conclusion :
Pour une souveraineté identitaire éclairée et outillée.
L’organisation du colloque national sur « La promotion de l’amazighité dans le cadre de la sécurité identitaire en Algérie » marque une inflexion stratégique dans la manière dont l’État aborde les enjeux identitaires. Ce n’est plus seulement une question de reconnaissance symbolique ou de réparation historique, mais un pilier actif de la stabilité nationale, de la résilience sociale et de la souveraineté culturelle.
En plaçant l’amazighité au cœur du récit national, dans toute sa légitimité historique et sa richesse civilisationnelle, l’Algérie affirme une vision mature de son identité : plurielle, inclusive, enracinée et tournée vers l’avenir. Mais pour que cette vision se traduise en politiques pérennes et résistantes aux tentatives de manipulation ou de fragmentation, elle doit s’appuyer sur des outils de compréhension fine, d’anticipation stratégique et de modélisation dynamique.
C’est à cette exigence que répond la Natiométrie, et plus spécifiquement le Natiomètre, en tant que dispositif scientifique inédit pour penser les nations comme des systèmes complexes. À l’heure où l’identité devient un terrain de conflictualité géopolitique, il est vital de se doter d’une intelligence systémique de la culture, d’une capacité algorithmique à discerner les équilibres symboliques, et d’une souveraineté cognitive sur les récits qui fondent les peuples.
Loin de s’opposer à l’universalisme ou à la modernité, cette démarche s’inscrit dans une logique de cosmopolitique enracinée, où chaque culture contribue, par sa singularité assumée, à la stabilité du monde. La sécurité identitaire, ainsi redéfinie, n’est plus le masque d’un repli, mais le socle d’un équilibre durable — un équilibre qui, en Algérie comme ailleurs, passe par la reconnaissance active de toutes les voix constitutives de la nation, au premier rang desquelles celle de Tamazight.
Amirouche LAMRANI.
Chercheur associé au GISNT.