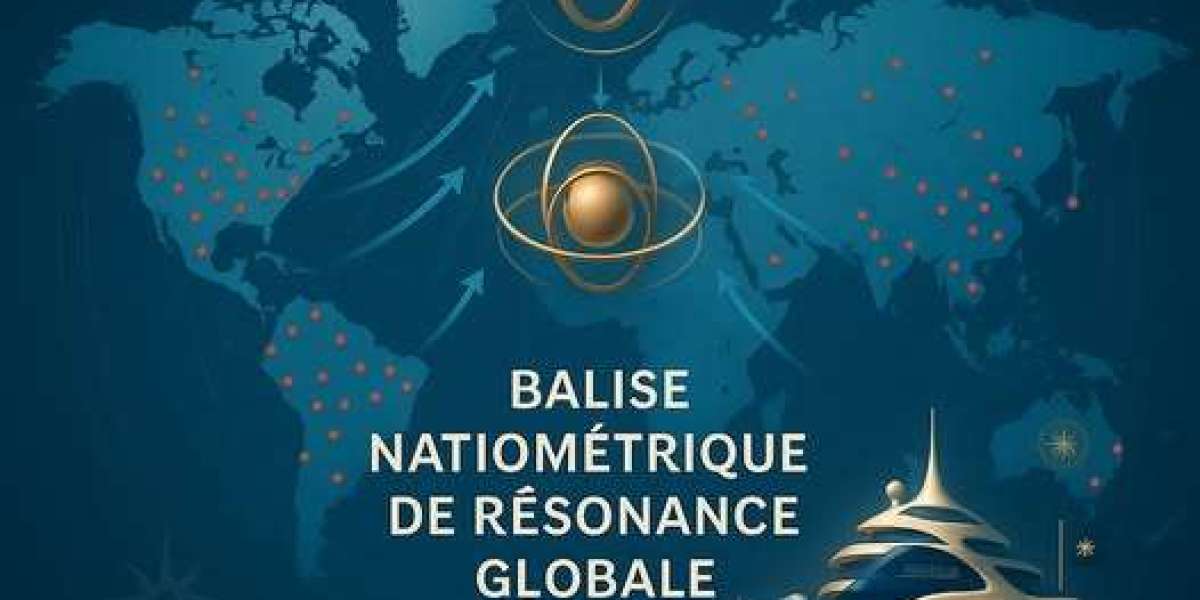Fiche conceptuelle académique : L’Agentivité
1. Définition générale
L’agentivité (agency en anglais) désigne la capacité d’un individu ou d’un collectif à agir de manière intentionnelle dans le monde, à influencer son environnement, à transformer les structures sociales et symboliques qui le conditionnent, et à se constituer comme acteur de sa propre histoire. Elle dépasse le simple libre-arbitre : elle suppose la conscience des déterminations, la faculté de choix, et la possibilité réelle d’exercer un pouvoir sur le cours des choses.
2. Origines et généalogie conceptuelle
- Philosophie antique : déjà présente dans l’idée aristotélicienne de praxis (l’action consciente, orientée vers une fin éthique).
- Sociologie moderne : Max Weber insiste sur le sens subjectif de l’action sociale, alors qu’Emile Durkheim tend à la subsumer sous la contrainte structurelle.
- Théorie critique : Michel Foucault analyse les conditions de subjectivation et montre que l’agentivité naît souvent dans la résistance aux dispositifs de pouvoir.
- Psychologie : Albert Bandura l’introduit explicitement comme concept scientifique (années 1980), définissant l’agentivité comme la capacité de l’individu à être l’agent de ses actions et à se percevoir comme tel.
3. Dimensions fondamentales de l’agentivité
- Cognitive – capacité de projection, anticipation, élaboration de scénarios d’action.
- Affective – énergie psychique et motivation qui soutiennent l’action.
- Sociale – possibilité d’agir collectivement et de se coordonner avec autrui.
- Institutionnelle – marge de manœuvre réelle laissée par les structures juridiques, politiques et organisationnelles.
- Symbolique – reconnaissance de la légitimité de l’acteur à agir, dans un champ culturel ou narratif donné.
4. Typologie de l’agentivité
- Individuelle : action personnelle face aux contraintes (auto-détermination, résilience, créativité).
- Collective : action concertée d’un groupe, d’un peuple, d’une nation (mobilisation, révolution, mouvement social).
- Structurelle : formes institutionnalisées permettant d’exercer l’action (citoyenneté, droits, gouvernance participative).
- Narrative : capacité d’un récit (individuel ou national) à mobiliser l’action et à légitimer les choix historiques.
5. Défis et limites
- Aliénation : domination structurelle qui réduit les marges de l’agentivité (colonialisme, inégalités systémiques).
- Illusion de l’agentivité : sentiment d’agir alors que les choix sont déjà conditionnés (consommation, idéologies).
- Fragmentation : difficulté de maintenir une cohésion entre agentivité individuelle et collective.
6. Importance stratégique dans le cadre de la Natiométrie
Dans la perspective natiométrique, l’agentivité devient une variable fondamentale du cycle de vie des nations.
- Elle mesure le degré d’auto-détermination d’une communauté face aux forces globales.
- Elle conditionne la résilience civilisationnelle : une nation qui conserve un haut niveau d’agentivité peut réorienter son destin même dans les crises majeures.
- Elle fonde la possibilité d’un roman national dynamique, capable de mobiliser les énergies créatives et politiques vers l’avenir.
7. Déclinaison opératoire
- Indicateurs natiométriques : degré de participation citoyenne, autonomie culturelle, souveraineté technologique, puissance narrative.
- Applications :
- Diagnostic de la vitalité nationale.
- Prévision des cycles de mobilisation ou de repli.
- Élaboration de stratégies de gouvernance proactive.
8. Référence croisée
- Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of human agency.
- Foucault, M. (1982). Le sujet et le pouvoir.
- Giddens, A. (1984). The Constitution of Society.